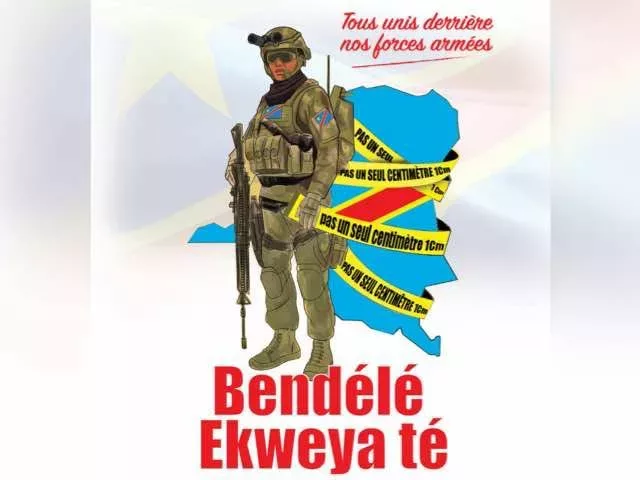Analyse de Maurice Mukendi/Expert économiste et financier.
La démocratie électorale en Afrique est devenue un marché juteux qui profite à une minorité, tout en imposant aux États des coûts exorbitants. Pendant que des milliards sont engloutis dans l’organisation des scrutins, les secteurs essentiels au développement, tels que l’agriculture, l’énergie ou l’éducation, restent sous-financés. Pourtant, l’histoire montre que les grandes puissances qui vantent aujourd’hui la démocratie ont d’abord consolidé leur développement économique sous des formes de gouvernance non démocratiques avant d’adopter ce modèle. Imposer la démocratie dès le départ, sans une base économique solide, revient à mettre la charrue avant les bœufs.
1. Le coût des élections en Afrique : une charge insoutenable
L’organisation des élections en Afrique est un gouffre financier. Voici quelques chiffres concrets qui illustrent cette situation :
• En République démocratique du Congo (RDC), les élections de 2018 ont coûté plus d’1,3 milliard de dollars, soit plus de 10% du budget national. Ce montant dépasse le budget alloué à la santé et à l’éducation combinés cette année-là.
• Au Nigeria, les élections de 2023 ont coûté environ 600 millions de dollars, un chiffre astronomique dans un pays où plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
• Au Kenya, les élections de 2022 ont coûté près d’un demi-milliard de dollars, un montant qui aurait pu financer la construction de plusieurs milliers d’écoles et hôpitaux.
• En Côte d’Ivoire, les élections présidentielles de 2020 ont coûté plus de 200 millions de dollars, tandis que le pays connaît un déficit en infrastructures de base.
Ces sommes faramineuses sont souvent financées par des bailleurs internationaux qui, en retour, gagnent une influence politique sur les dirigeants africains. Pendant ce temps, la population ne voit aucune amélioration concrète de ses conditions de vie après chaque scrutin.
2. Un leadership fort et une économie productive avant la démocratie
Les grandes puissances démocratiques actuelles n’ont pas adopté ce modèle dès le départ. Elles ont d’abord consolidé leur économie et leur souveraineté sous des régimes forts avant de faire évoluer leur système politique.
• La France : Avant d’être une démocratie stable, la France a connu des monarchies absolues et un empire dirigé par Napoléon. Ce n’est qu’après son développement économique et la structuration de son État qu’elle a adopté progressivement la démocratie.
• Les États-Unis : Bien que proclamés démocratiques dès leur indépendance, les États-Unis ont fonctionné longtemps sous un modèle où seuls les élites blanches possédaient des droits politiques réels. Ce n’est qu’après leur expansion économique et industrielle qu’ils ont progressivement élargi la démocratie à toutes les catégories de citoyens.
• L’Allemagne : Ce pays a connu plusieurs formes de gouvernance (Empire prussien, régime autoritaire, dictature nazie) avant de devenir la démocratie stable et puissante d’aujourd’hui.
• La Chine et Singapour, bien qu’ayant des formes de gouvernance non démocratiques, sont devenus des modèles de réussite économique grâce à une planification stratégique et un leadership fort.
Ces exemples montrent que la démocratie électorale n’est pas une condition préalable au développement. Au contraire, elle peut être un frein si elle est imposée trop tôt, sans une base économique et sociale solide.
3. Un secteur clé à prioriser : l’agriculture pour l’autosuffisance et l’industrialisation
Plutôt que de gaspiller des milliards dans des élections qui ne résolvent pas les problèmes de gouvernance, l’Afrique devrait investir massivement dans un secteur productif capable d’assurer un développement durable et un bon social : l’agriculture et l’agro-industrie.
L’Afrique possède 65% des terres arables non exploitées du monde, mais reste dépendante des importations alimentaires. Investir dans l’agriculture permettrait de :
• Créer des millions d’emplois pour les jeunes et réduire le chômage.
• Garantir la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux importations.
• Développer une agro-industrie locale, en transformant les matières premières sur place au lieu d’exporter des produits bruts.
• Générer des revenus pour financer des infrastructures essentielles comme les routes, les hôpitaux et les écoles.
À titre d’exemple, avec 1,3 milliard de dollars (le coût des élections en RDC en 2018), on pourrait :
• Financer 10 000 fermes modernes équipées de machines agricoles.
• Construire plus de 200 usines de transformation alimentaire.
• Réhabiliter des milliers de kilomètres de routes rurales pour faciliter le transport des produits agricoles.
En privilégiant ces investissements au lieu des élections coûteuses et souvent frauduleuses, l’Afrique pourrait bâtir une base économique solide et assurer un bon social à sa population.
4. Vers un modèle de gouvernance plus adapté à l’Afrique
Plutôt que de copier un modèle électoral occidental inadapté, l’Afrique doit repenser son système de gouvernance en s’inspirant de ses réalités historiques et des modèles qui ont fonctionné ailleurs. Un bon leadership ne se mesure pas uniquement par des élections, mais par la capacité à améliorer la vie des citoyens.
Un modèle hybride pourrait être envisagé :
• Un État fort et visionnaire, capable de planifier sur le long terme et d’assurer la stabilité.
• Une participation populaire réelle, où les citoyens ont un droit de regard sur les décisions économiques et sociales sans se limiter au simple vote tous les cinq ans.
• Un système méritocratique, où les dirigeants sont sélectionnés sur la base de leur compétence et non de leur capacité à faire campagne.
• Un contrôle des citoyens, avec des assemblées locales et des conseils communautaires permettant de surveiller les actions du gouvernement.
Conclusion : La démocratie, un produit bien marketé mais inefficace pour l’Afrique
La démocratie électorale en Afrique est une invention lucrative qui profite à une minorité et appauvrit les États. Son coût exorbitant détourne des ressources qui pourraient être investies dans des secteurs stratégiques comme l’agriculture, l’énergie ou l’éducation.
L’histoire montre que les grandes puissances démocratiques d’aujourd’hui ont d’abord consolidé leur développement sous des régimes forts avant d’adopter progressivement la démocratie. Vouloir imposer la démocratie en Afrique sans une base économique solide, c’est comme vouloir construire un gratte-ciel sur du sable.
L’Afrique n’a pas besoin d’élections coûteuses et contestées, mais d’un leadership fort, visionnaire et pragmatique, capable d’investir dans des secteurs productifs et d’assurer un bon social pour la population. C’est ainsi que le continent pourra véritablement s’émanciper et bâtir son propre modèle de gouvernance adapté à ses réalités.